

Phobie scolaire : la comprendre, la repérer, la soigner
Aujourd’hui très médiatisée, la phobie scolaire est encore mal connue et peu accompagnée. De quelles peurs parle-t-on ? Quels en sont les causes et les symptômes ? Comment réagir ? Nous avons interrogé la pédopsychiatre Hélène Denis.
«Ça a commencé par des plaintes chaque dimanche soir, raconte Sacha, 43 ans. Lila n’avait pas envie d’aller à l’école, puis avait du mal à respirer et finissait par s’effondrer, en larmes. Avec Thomas, on a mis ça sur le compte du stress : notre fille venait d’entrer en 6e, il y avait forcément une période d’adaptation avec le primaire, ça allait passer. »
Mais, malgré les câlins, les paroles rassurantes, les bains chauds, la petite fille a bien du mal. Tout au début du mois de janvier suivant, alors que les vacances de Noël s’étaient bien passées, Lila refuse catégoriquement de reprendre le chemin du collège. Et le médecin de famille alerte ses parents. « Il a évoqué la possibilité d’une phobie scolaire. On est tombés des nues. Pour nous, la phobie, c’était la peur des araignées ou des ascenseurs. Pas d’un établissement où ma fille était censée grandir, apprendre, s’épanouir. Être heureuse. »
Quatre critères pour repérer la phobie scolaire
« La majorité des études qui viennent des pays anglo-saxons définissent le refus scolaire anxieux avec quatre critères cliniques », explique la pédopsychiatre Hélène Denis :
- réticence ou refus fréquent d’aller à l’école ;
- détresse émotionnelle à la perspective de devoir aller à l’école, se traduisant par une crainte excessive, des crises de colère, de la tristesse ou des symptômes physiques inexpliqués ;
- recherche du confort et de la sécurité de la maison, les absences scolaires ne sont pas dissimulées aux parents ;
- absence de comportements antisociaux significatifs, efforts raisonnables des parents pour assurer la présence de l’enfant à l’école.
Une peur multiforme
C’est un mal dont on parle aujourd’hui beaucoup. « Le terme “phobie scolaire” est employé dans le langage courant pour définir la peur du milieu scolaire, précise Hélène Denis, pédopsychiatre et co-autrice de La phobie scolaire ; 100 questions/réponses (Ellipses) avec Estelle Caron, également pédopsychiatre. Pourtant, il ne relève pas de la phobie telle qu’on l’entend. Quand on a une phobie, on a peur d’un endroit ou d’un animal, on déclenche une crise d’angoisse quand on y pense ou quand on est devant, mais les autres situations ne sont pas anxiogènes. »
Or, le sentiment de panique éprouvé par ces enfants et ces adolescents est différent. « Pour la phobie scolaire, les tableaux ne sont pas aussi simples. Les jeunes patients ont peur de différentes choses : des transports en commun pour se rendre à l’école, de la foule dans la cour, de camarades qui les malmènent, voire les harcèlent, d’être interrogés à l’oral, de ne pas avoir de bonnes notes, de vomir dans la classe devant tout le monde, d’être loin de chez eux. » Ils peuvent aussi souffrir d’une anxiété plus diffuse qui va se fixer sur la scolarité. Autant de bonnes raisons pour ne plus pouvoir attraper son cartable le matin. C’est donc le nom de « refus scolaire anxieux », ou RSA, qui est désormais celui sur lequel s’accordent les spécialistes.
Mais là encore, il n’existe pas vraiment de définition unanime. « Il s’agit d’un terme récent qui recouvre des troubles sous-jacents différents, confirme la pédopsychiatre. Et ces troubles ne constituent pas une catégorie diagnostique indépendante dans les systèmes de classification internationaux des troubles mentaux. »
Dans le DSM-5, la classification de l’Association américaine de psychiatrie, ils font partie des troubles de l’anxiété de séparation. L’OMS, dans sa classification internationale des maladies (CIM), ne les mentionne pas de façon explicite.
En France, la classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA) tente tout de même de préciser le RSA : « manifestations d’angoisse majeure avec un phénomène de panique liées à la fréquentation scolaire, ce qui interdit sa poursuite sous les formes habituelles. »

De réels symptômes invalidants
Ces manifestations, Côme, 19 ans, en parle encore avec beaucoup d’émotion dans la voix. Il était alors en 3e : « Je sentais une tension me tordre le ventre et le cerveau. Comme un énorme poids qui m’empêchait de manger ou de dormir. J’y pensais en permanence, j’avais des images, des flashs… Sauf quand j’arrivais à convaincre mes parents de rester à la maison. Alors, ça allait mieux et je pouvais me reposer, lire ou regarder une série. Bref, ne plus y penser. Jusqu’au soir. »
La terreur est telle que les patients présentent de réels troubles physiologiques : douleurs abdominales, troubles digestifs, maux de tête, nausées, insomnies, vertiges, sudations, vomissements, diarrhées, douleurs musculaires. Pour pallier l’angoisse, une seule solution : éviter coûte que coûte la situation, dans un réflexe de fuite salutaire qui, depuis la nuit des temps, fonctionne.
Quand on a peur de quelque chose, le plus simple est encore de s’y soustraire. Et pourtant, ces élèves en mal d’école veulent y aller ! « Ils restent motivés, concernés par leur scolarité, reprend Hélène Denis. Ils sont de bonne foi quand ils promettent qu’ils y retourneront le lendemain. Ils en ont envie… mais ne peuvent pas. » Côme dit ainsi qu’il n’a « pas tout de suite fait le lien avec l’école. J’aimais ça, j’avais des copains et des résultats corrects. Et puis, tout s’est embrouillé. Avec la psy qui m’a suivi pendant deux ans, on a bien évoqué ma déception amoureuse de l’époque — je m’étais pris un vent, comme on dit. J’étais aussi mal dans ma peau, beaucoup trop grand par rapport aux autres, sensible. Mais… comme tout le monde, non ? Sauf que tout le monde ne souffre pas de phobie scolaire. »
La TCC, une approche efficace
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une thérapie brève, validée scientifiquement, qui vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité. Elle a notamment démontré son efficacité dans le traitement des troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent, dont le refus anxieux scolaire fait partie.
Un trouble en augmentation
Si « tout le monde », en effet, n’en souffre pas, quels sont les chiffres de ce trouble ? « Le refus scolaire anxieux toucherait entre 1 % et 5 % des enfants en âge d’aller à l’école, et 8 % des patients suivis en pédopsychiatrie, précise la spécialiste. Cependant, il est difficile de savoir précisément combien sont réellement concernés. Pour deux raisons essentielles : d’abord, faute de critères diagnostiques clairs ; et puis, nous n’avons pas d’outils de dépistage précis. Par exemple, si nous avons accès aux chiffres de l’absentéisme, nous n’en connaissons pas les causes exactes qui sont plurielles. »
Décrochage, école buissonnière, pathologies… Les raisons de ne pas aller à l’école ne sont pas spécifiquement liées à une trop forte anxiété. Une anxiété qui s’invite désormais davantage dans les salles de classe. « Cette pathologie est de plus en plus médiatisée, ce qui serait le reflet de la place importante qu’occupe la scolarité dans notre société, analyse Hélène Denis. Deux hypothèses sont aujourd’hui mises en avant : d’une part l’engagement pressant, voire souvent anxieux des familles face à la scolarité ; et d’autre part la valorisation des études et les exigences de performance souvent croissantes. » La pression de la société serait-elle insoutenable ? L’environnement, trop anxiogène pour des jeunes encore fragiles ?
Les plus jeunes aussi
L’angoisse peut venir perturber n’importe quel enfant, que celui-ci ait manifesté auparavant une forme d’anxiété ou non. On retrouve plusieurs pics de fréquence : dans la petite enfance (5-7 ans), à la préadolescence (10-11 ans) et à l’adolescence (13-15 ans). Ces pics correspondent à des paliers d’accès à l’autonomie, mais aussi à des classes charnières en termes d’apprentissage. Le premier pic marque l’entrée à l’école primaire, le second l’entrée au collège et le troisième correspond à une période classique d’apparition de troubles anxieux. Si les cas les plus fréquents s’observent au collège et au lycée, les plus petits ne sont pas épargnés, ce qui était peu le cas jusqu’ici. Depuis, la pandémie est passée par là. Et les mesures prises pour l’enrayer ont eu un impact sur la santé mentale des plus jeunes.
Des chercheurs de l’Inserm et de l’Ined ont ainsi révélé que « 13 % des enfants de 8 ans à 9 ans ont été concernés par des troubles socio-émotionnels pendant le confinement ». Ces données ont été complétées par une étude menée cette fois-ci en Chine « qui montre que les trois principaux symptômes qui se sont manifestés pendant l’épidémie chez les enfants étaient l’anxiété, la dépression et le stress. » Un mal-être qui a pu se cristalliser sur le milieu scolaire.
Autre effet délétère du confinement : il a rendu non seulement possible, mais acceptable l’idée de ne pas aller à l’école. C’est d’ailleurs ainsi que Faustine, en CM2 cette année, a longtemps justifié sa demande auprès de ses parents qui témoignent : « Déjà, elle n’a jamais voulu y retourner au printemps 2020 quand l’établissement a rouvert ses portes. Le CM1 a ensuite été difficile, mais c’est à la rentrée de septembre 2021 qu’elle a trouvé la solution : poursuivre sa scolarité… en distanciel ! Comme pendant la crise sanitaire. »
Patience et bienveillance
Pour Hélène Denis, cette piste n’est pas la première à envisager : « Il est préférable de prendre en charge l’anxiété de l’enfant avant de chercher à poursuivre, dans l’urgence et sans soins, ses apprentissages. Le recours à l’enseignement à distance est un évitement organisé qui contribue à banaliser la situation et enferme l’enfant dans l’isolement. Or, il a impérativement besoin d’être accompagné pour pouvoir reprendre une vie “normale”, les interactions sociales étant nécessaires à son développement. »
Que faire alors ? D’abord, changer de regard sur le comportement de ceux et celles que l’on imagine rebelles. Il ne s’agit ni d’un caprice ni de mauvaise volonté. Les parents, les proches, mais aussi les acteurs de la communauté éducative doivent faire preuve de bienveillance, d’écoute, de compréhension, de reconnaissance, et surtout de patience, car il y a bel et bien souffrance. Petits et plus grands doivent retrouver confiance en eux, en leurs ressources, en leurs capacités. Ils y parviendront en procédant par étapes, en se fixant de petits objectifs raisonnables, à leur portée.
L’idée ? Faire le plus petit pas possible, mais en faire un quand même, puis deux, puis trois, toujours l’un après l’autre. Lila, aujourd’hui en 4e raconte : « Au début, on est allés avec mon psy au coin de la rue ! Ensuite, juste devant le collège. Un jour, nous sommes entrés pour bavarder avec la directrice. Et comme ça, jusqu’à ce que je puisse me rendre en classe, assister à un cours — les maths parce que j’adore ça. »
Le refus scolaire anxieux se soigne, souvent grâce à une thérapie comportementale et cognitive, selon Hélène Denis qui, souvent, passe un pacte avec ses patients : le retour à mi-temps avant la fin de l’année scolaire et une rentrée en bonne et due forme au mois de septembre suivant. Elle observe entre 50 % et 80 % de guérison au bout d’un an.
« Il ne faut pas attendre et laisser la pathologie s’installer, car des solutions existent. Mieux vaut reconnaître les difficultés rencontrées par son enfant, ne pas hésiter à en parler à son médecin traitant ou à contacter des associations, comme l’APS, qui sauront aider les familles à trouver des structures adaptées ou des interlocuteurs privilégiés. » Chaque enfant est différent et le parcours de soins s’établira en fonction. Dans un même but : reprendre le chemin de l’école.
La feuille de route de l’APS
« Ne vous affolez pas, ne culpabilisez pas, mais entendez-le ! » C’est par ces mots que commence la feuille de route rédigée par l’Association contre la phobie scolaire qui rappelle qu’il « faut agir dès l’apparition des premières somatisations ».
Voici ses conseils :
- mettre en place une pause : arrêt maladie de trois semaines pour l’enfant ;
- vérifier l’éventualité d’un harcèlement (par un adulte encadrant, un ou des élèves) ;
- évaluer le profil cognitif pour repérer notamment d’éventuels troubles des apprentissages ;
- prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre pour définir le meilleur traitement ;
- mettre en place un dispositif temporaire d’instruction à domicile ;
- entreprendre la thérapie appropriée au sein d’une structure ou auprès d’un psychologue ;
- en parallèle, trouver de l’aide pour la famille si nécessaire et se préserver.
Aurore AIMELET
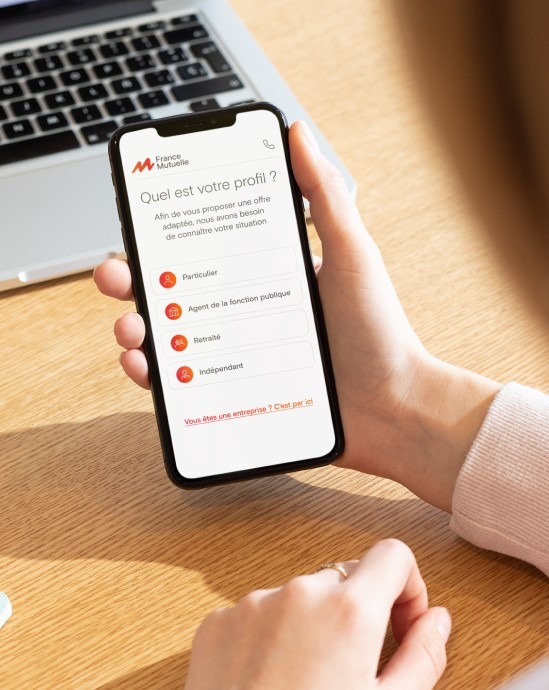
À la recherche d’une offre adaptée à vos besoins ?
Particulier, professionnel ou collectivité, adaptez votre offre en fonction de vos besoins actuels et futurs.
Un conseiller pourra répondre à vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.





